Guy Dana
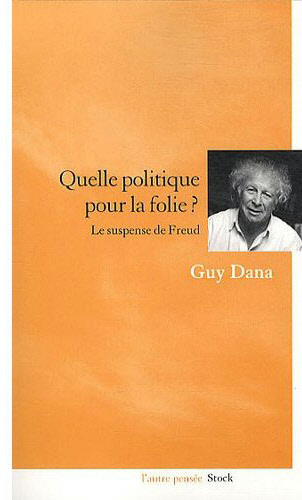
Dans ce livre centré sur la notion d’espace, Guy Dana expose sa conception du travail de secteur avec la psychose, conception politique d’une organisation des lieux envisagée sous l’éclairage de la psychanalyse pour aboutir à la notion d’une « cure sectorielle » des patients psychosés, formule qui consacre le lien entre psychanalyse et politique.
Comment gagner de l’espace pour penser et exister? Pourrait être la question directrice de cet ouvrage ; avec la psychanalyse et le dispositif sectoriel, l’auteur propose une réponse.
Il démarre d’un constat : celui d’une certaine congruence entre la modernité et la psychose dans le traitement de l’espace.
En effet, Guy Dana constate que la modernité telle que nous la connaissons, toute préoccupée de la performance, tend vers la clôture, l’évitement de l’élaboration, la lutte contre l’inattendu, l’évitement voire la négation du conflit et notamment du conflit psychique.
En psychiatrie, dans nos services, nous pouvons le constater à travers le développement des normes et des protocoles, réponses toutes faites et rendues obligatoires par une évaluation pensée comme une vérification, annulant de ce fait la réflexion, le débat, la dispute entre professionnels.
De même, l’esprit gestionnaire et
rentabiliste de la loi HPST, réorganisant l’hôpital public, prône une
fermeture des structures peu rentables vécues comme coûteuses en argent,
c’est-à-dire les établissements de proximité, pour favoriser le rassemblement et la mutualisation des moyens dans des sites uniques.
Ces deux exemples témoignent d’une volonté de « mise en ordre », d’uniformisation des pratiques et des lieux.
Par ailleurs, la langue promulguée par
la modernité est une langue occupée, pleine, « positive », prônant la
transparence, l’adéquation, la traçabilité. Niant le conflit psychique
et la division du sujet, la méconnaissance que chacun entretient avec
lui-même, elle opère une tentative de saturation de l’espace, de
colmatage des brèches Or, remarque l’auteur, la rhétorique de la
modernité et son fonctionnement voisine avec la sémiologie psychotique.
En effet, la psychose peut être
considérée comme une organisation défensive contre la discontinuité,
l’inattendu, le conflit psychique, la pensée incidente vécue comme
étrangère. Nous le constatons dans la clinique : les patients psychosés
se prêtent mal à l’inattendu, le conflit psychique leur est
difficilement soutenable. Ils lui préfèrent la sécurité d’un monde
objectivé par le délire, fournissant des certitudes et permettant
d’évacuer un questionnement existentiel alors vécu comme extérieur et
persécutant.
Dans la psychose comme dans la
modernité, il existe une lutte contre la discontinuité, la séparation,
la différenciation et une tendance à l’uniformisation et à
l’aplanissement des conflits.
A l’inverse de cette tendance, la
psychanalyse, s’appuyant sur l’imprévisible de l’association libre et
favorisant la familiarisation du sujet avec sa part méconnue,
inconsciente, se donne pour but de lever un interdit de penser, d’ouvrir
un espace. Un espace permettant un accueil modifié de l’inattendu,
l’augmentation du champ du décidable.
En cela, elle est un gain de liberté et favorise l’émergence du sujet.
Elle est l’envers de la passion de l’ignorance.
En mettant en rapport espace psychique,
intervalle entre les mots, espace géographique, en soulignant l’intimité
qui existe entre territoires psychiques et territoires géographiques,
l’auteur propose une conception du travail avec la psychose « au cœur de
la ville comme au cœur du langage ».
Cela est possible grâce au dispositif du secteur.
Partant de l’idée qu’il est possible de
penser l’articulation des lieux comme l’articulation des signifiants,
dont le but, en formant une chaîne signifiante, est de sortir d’une
bouillie indistincte dénuée de mots différenciés, il propose une manière
de penser les lieux de soins qui favoriserait la relance de la
symbolisation, de l’individuation, du travail psychique.
Le secteur est ici pensé comme un
contenant à plusieurs lieux, des lieux articulés comme des signifiants,
dont aucun n’est le centre car il n’existe pas de centre mais une
circulation. L’intervalle entre les lieux répond à l’intervalle entre
les mots, fournit un espace vide permettant l’émergence d’un travail
psychique. Pour un patient donné, des transferts se nouent avec les
soignants, avec les différents lieux ; ces transferts qui évoluent,
naissent et disparaissent au gré des séquences institutionnelles,
favorisent le fait de recommencer plutôt que de répéter indéfiniment,
recommencement dont on peut penser qu’il permet finalement, chez des
patients qui se réfugient si finalement dans un hors temps, de
transformer les événements en mémoire, de constituer une histoire
personnelle, un sujet qui tolère avec moins de difficulté l’inattendu et
l’étranger qui est en lui.
Un sujet qui, finalement, gagnant en espace, gagne en liberté.
